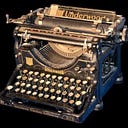Billet d’un 3 novembre à ma nièce Corinne
Dans des textes antérieurs, j’ai brièvement abordé certains rituels de l’époque: saluer presque tous les voisins avant de laisser le pays, etc. Il existe peu de témoignages photographiques sur l’arrivée à l’aéroport. Ceux qui allaient prendre l’avion étaient protocolairement vêtus; ceux qui accompagnaient aussi. Un véritable défilé de mode.
Entre-temps, je n’ai pas cessé d’étudier notre diaspora familiale et les autres; celles des villes et celles des campagnes. Les accidents héroïques ne suffisent pas pour construire un pays. Nous sommes une terre d’exilés, de déportés et de rescapés. Avec le temps, les fanfaronnades gouvernementales s’effritent. «Le pays fut bon» à telle époque, prétendent les uns. Lorsque tu te mettras à fouiller sincèrement, tu te rendras comptes qu’en Haïti le mensonge est une vertu historique. Le Nouvelliste du 14 novembre 1966 nous apprend en première page un nouveau chapitre des relations d’hier entre Haïti et la République Dominicaine: la diplomatie de la zafra…
Au début des années 80, lorsque j’apprends qu’un caporal habitant à la place Sainte Anne tua sa femme d’une balle de fusil puis se suicida, je demandai à ton grand-père «comment est-ce possible? ». Pour réponse, il me donna un billet neuf de 50 gourdes, avec un lourd regard silencieux.
Je devais me rendre dans le voisinage du caporal pour mieux comprendre. J’avais dans le quartier des amis et connaissances. A mon retour à la maison, un rapport fut sec: -Papa, le caporal et sa femme sont morts de misère.
Le régime des Duvalier est à revisiter avec beaucoup de précautions. Longtemps considéré comme «mauvais gouvernement», il s’est imposé -grâce à la bêtise des successeurs- comme l’unique référence des minces réalisations de l’histoire haïtienne. Deux patriarches (Mc Intosh et Bayard) qui eurent la confiance respective de Duvalier père et du fils héritier ont écrit en majuscules l’histoire des vols commerciaux dans nos cieux depuis presque 60 ans.
Le 3 novembre 1967, oncle Fefe prenait le vol de la Pan Am (Pan American World Airways) pour New York. Lorsque je suis passé le visiter à N.Y. vers la fin de la décennie 80, en compagnie de Charles, la Pan Am était déjà presqu’un souvenir dans les cieux d’ici et d’ailleurs.
Gilbert Mervilus, 3 novembre 2024
Notes: De 1915 à 1934, Georges Anglade estime qu’entre 200 et 300.000 haïtiens auraient été travailler en République Dominicaine et le double à Cuba.
Entre 1957 -année de l’arrivée au pouvoir de Papa Doc- et 1963, 6 800 haïtiens entrèrent aux États-Unis avec un visa d’immigrant et 27 300 autres avec un visa temporaire.
Source: La diaspora haïtienne, Cédric Audebert, Open Edition, 31 janvier 2017