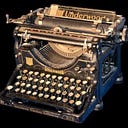Commentaires de Hugo Tolentino sur «l’agression contre Lescot» de Bernardo Vega
Hoy, 6/08/2007. Synthèse et adaptation au français (1135) G.M. Texte en espagnol «Comentarios de Hugo Tolentino D. a obra
sobreTrujillo y Lescot de Bernardo Vega » (4189 mots)
Je remercie Bernardo Vega pour la demande de présentation de cette nouvelle œuvre, ainsi que pour le geste d’amitié témoignant de la possibilité offerte pour souligner la valeur d’une enquête sérieuse sur une période vertébrale de l’histoire politique des deux nations qui partagent l’île de Saint-Domingue.
«L’agression contre Lescot» est le titre du troisième volume concernant Trujillo et Haïti publié par Vega. La production de la prolifique plume de Bernardo Vega clôture aujourd’hui la période qui se déroule de 1939 à 1946, dates qui incluent les deux dernières années et demie du gouvernement du président haïtien Stenio Vincent et les relations entre Trujillo et Elie Lescot depuis le Moment où celui-ci a exercé les fonctions de ministre plénipotentiaire en République dominicaine et au même rang à Washington, jusqu’à accéder à la présidence de son pays et y demeurer de mars de 1941 à janvier 1946.
Je n’entends pas, avec les annotations suivantes, entreprendre un travail d’exégèse, car le lecteur trouvera dans son contenu des faits et des explications qui expliquent et épuisent de manière exhaustive les sujets abordés. Dans ce travail sont exposés les événements qui permettront une bonne compréhension du cours historique entre la République dominicaine et la République d’Haïti au cours du cycle susmentionné.
Vega analyse dans ces pages comment, à partir de la fréquentation politique de Trujillo par les gouvernements de Stenio Vincent et Elie Lescot, des attitudes contradictoires et aberrantes vont apparaître, exacerbées par des conceptions enracinées dans la conscience de certains secteurs de la société dominicaine et par le délire que le pouvoir est capable de créer dans le comportement de certains chefs d’État. Pour orienter ces commentaires, j’ai décidé de choisir les comportements qui, en raison de leur survivance continuent de susciter des difficultés graves et irritantes dans les deux pays.
C’est pendant le gouvernement de Stenio Vincent que la présence de travailleurs haïtiens en République dominicaine suscitera des réactions sociales et des désaccords politiques, dont certains auront des conséquences effrayantes, comme le génocide perpétré sous les ordres de Trujillo en 1937.
À cet égard, Vega nous dit: «Depuis le début du XXe siècle, les propriétaires d’usines dominicaines, la grande majorité au capital américain, ont réussi à importer de la main-d’œuvre haïtienne pour remplacer celle des îles des Caraïbes anglophones et portoricaine, parce que c’était moins cher». Je dois me rappeler que dans notre pays, tout au long du XIXe siècle, depuis les grands pressoirs jusqu’à l’installation des usines de propriétaires étrangers, en particulier des Cubains qui ont quitté leur île, effrayés par la guerre d’indépendance, ce furent les Dominicains qui effectuèrent le travail de couper la canne. Dans les années 1874 à 1882, ces entrepreneurs ont créé entre trente et trente-cinq usines sucrières.
Mais le désir, plutôt l’ambition, d’augmenter la plus-value produite par la canne à sucre a conduit les Américains, occupants militairement Haiti à l’époque et les autres propriétaires de sociétés sucrières vers le bracero haïtien. Un simple détail le confirme: en 1893, le travailleur agricole dominicain, recevait deux pesos pour couper la canne à sucre, tandis qu’en 1925, à l’étranger, pour le même travail, gagnait à peine quatre-vingt centimes On dit souvent que le dominicain ne coupe pas la canne, ce qu’il faudrait dire c’est qui ne la coupe pas à un prix dérisoire
[…]
Ce trafic illégal a servi de prétexte à Trujillo pour ordonner le génocide des Haïtiens en 1937. « Les Haïtiens qui travaillaient dans telle zone géographique pour des hommes d’affaires étrangers ont été exclus, de même que les braceros de l’usine de Montellano et les employés de la yuquera de Quinigüa ».
«L’objectif qu’il aurait pu avoir d’ordonner la mise à mort était désormais soumis aux intérêts des usines». Vega souligne qu ‘«en 1939, le gouvernement dominicain a continué à accorder des dérogations à la loi exigeant qu’une certaine proportion de Dominicains travaillent dans les usines». «Le massacre de 1937 ne constituait donc pas un obstacle empêchant le trafic d’ouvriers haïtiens»
L’acrimonie du dictateur dominicain a dépassé les limites de la diplomatie pour devenir d’une thèse anthropologique prétentieuse et méprisable dans l’approche de la société haïtienne. Et c’est vrai, car bien que la réaction de Trujillo soit à l’origine de contradictions personnelles entre le dictateur dominicain et Lescot, la première tentative de contrarier personnellement le président haïtien a été largement projetée dans un discours idéologique de portée nationale et internationale. Les arguments avancés ont atteint une dimension telle que l’on peut encore percevoir, selon l’avis de certains secteurs, les sédiments boueux de préjugés laissés chez certains dominicains face au peuple haïtien.
Qu’avec Trujillo et à ce carrefour politique, le racisme ait été repris comme le pilier de toute une croisade xénophobe, cela ne voulait pas dire que le dictateur dominicain en était le créateur original et historique. À partir de ce moment, le racisme s’ajouterait aux circonstances particulières des relations historiques entre les deux nations, afin de valider la rencontre et d’homologuer la diffamation. Sans parler des invasions de Toussaint et Dessalines dans la partie espagnole, de l’occupation haïtienne pendant 22 ans avec Jean-Pierre Boyer et des guerres avec Haïti ont laissé un résidu de ressentiment.
Le même parti-pris de nationalisme mensonger qui caractérisait la politique de Trujillo imprégnait Lescot dans sa politique, sans racisme, mais essayant de manière opportuniste de créer autour de lui une solidarité populaire suscitée par ses intérêts personnels. Par ailleurs, la dualité de Trujillo était déconcertante, car accorder des licences pour l’immigration de travailleurs haïtiens encourageait l’opprobre racial. «Face à l’orientation prise par la politique dominicaine vis-à-vis du pays voisin, Lescot réagit par un décret-loi du 11 septembre 1942 sur l’émigration des Haïtiens, dans lequel il n’y avait plus d’ambiguïtés, car les menaces de l’interdire mettaient à nu la supercherie «si les circonstances le permettent, le départ d’un certain nombre de travailleurs agricoles», déclara le président haïtien.
Deux mois après le décret-loi de Lescot, limitant sérieusement l’accès des braceros haïtiens à la République dominicaine, Trujillo ordonna une féroce campagne de nature idéologique contre le peuple haïtien. Pendant dite campagne, pour remercier Trujillo pour la dominicanisation de la frontière, Manuel Arturo Peña Batlle a prononcé un discours dans la ville d’Elías Piña, dans lequel, entre autres choses il déclara «Haïti comme un État irréalisable».
Le 14 décembre 1945, Lescot quitte Haïti et se déclare exilé politique à Montréal, au Canada. Vega a raison quand il observe que c’est entre 1942 et 1945 que l’anti-haïtianisme, basé sur une thèse raciste, est devenu officiel. Ce travail propose de nombreux enseignements pour la méditation sur les événements historiques et politiques d’une époque ainsi que sur les relations actuelles entre la République dominicaine et Haïti.
Merci Beaucoup
Synthèse et adaptation au français (1135) G.M.Texte en espagnol «Comentarios de Hugo Tolentino D. a obra
sobre Trujillo y Lescot de Bernardo Vega » (4189 mots)