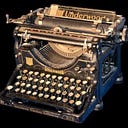LE PROBLÈME DU LOGEMENT par Dantès Bellegarde
Hygiène et pudeur nationale (introduction)
Une Section Haïtienne du Rotary Club s’était formée dans les premiers jours de 1920. Elle comprenait des Américains, comme MM, Elliot, Von Schilling, Berlin, des commerçants comme M, Edouard Estève, des journalistes comme MM, Clément Magloire et Ernest Chauvet, des professeurs, ingénieurs, avocats, comme MM, Horace Ethéart, Frédéric Doret, Louis Borno, Son but principal était d’étudier tous les moyens d’assainir et d’embellir Port-au-Prince. Elle tenait son déjeuner hebdomadaire chez Dereix, et, au dessert, on discutait les projets qu’à tour de rôle présentait et défendait chacun des membres. C’est ainsi que l’on consacra de nombreuses séances à la discussion des mesures les plus efficaces pour la protection de la capitale contre le fléau redoutable de l’incendie.
À la séance du 27 avril 1920, j’attirai l’attention de mes collègues sur le spectacle affreux qu’offrent à toutes les heures du jour les rues de Port-au-Prince, pleines de mendiants loqueteux, de portefaix en guenilles et d’infirmes portant sur leur corps des plaies purulentes. J’insistai particulièrement sur la nécessité d’étudier un projet de construction de maisons populaires saines, confortables et à loyers réduits. Le spirituel collègue, chargé du rapport sur mes deux propositions, les étouffa proprement sous les fleurs. Et comme j’étais à cette époque membre du gouvernement, un aimable journaliste de l’opposition, qui s’était « spécialisé » dans la critique de ma personne, de mes paroles et de mes actes, en prit prétexte pour m’accuser des plus noirs desseins : je voulais, écrivit-il, « vendre le pays à des compagnies étrangères », et faire en même temps du « bolchevisme », — ce qui était quelque peu contradictoire. Un autre, tout aussi « bien informé », me reprocha durement mes tendances à l’étatisme. Bref, je fus considéré par certains politiciens comme un dangereux « pêcheur de lune », et par quelques autres comme un malfaiteur. Et pourtant, y a-til un problème qui soit plus angoissant et plus urgent que celui des logements populaires ?
Nous pouvons aujourd’hui discuter cette question avec plus de calme et sans risquer de passer pour un criminel, puisque le Président de la République, en entreprenant la transformation de la Saline, a mis au premier rang des préoccupations d’un véritable gouvernement de progrès social la solution du problème des habitations salubres à bon marché.
Ceux qui visitent aujourd’hui la Cité-Vincent ne peuvent s’imaginer ce que présentait d’effroyable cette agglomération de « cases » de la Saline, transformée en cité lacustre à la saison des pluies. Ont-ils connu la Cour-des-Pisquettes ? Elle aussi est en voie de transformation. Mais d’autres sections de la ville offrent encore le spectacle de la laideur et de la saleté. Dans ces quartiers grouille une population misérable et pouilleuse. C’est là que vous trouverez ces maisonnettes à cinq gourdes par mois, — loyers déjà trop lourds pour la bourse de nos ouvriers et hommes de peine. Entrez-y un instant, quelque mal qu’en éprouve la délicatesse de vos narines. Entrez-y en compagnie du médecin que le devoir y appelle quelquefois, et voici le lamentable spectacle qui frappera vos yeux : un bouge ignoble, servant à la fois de chambre-à-coucher, de cuisine, de lavoir et de tout le reste. Pas de lit : le malade couché sur une natte de jonc ou sur la terre battue recouverte de vieilles hardes malpropres, souillées de déjections. Pas de chaises. Des murs lézardés qui laissent entrer le vent. Une toiture criblée de trous qui laisse passer la pluie. Quand on songe qu’en ce pays d’air pur et de lumière radieuse, des milliers de Haïtiens s’entassent ainsi pêle-mêle dans de tels taudis, on se sent un peu honteux et vaguement inquiet.
Inquiets ! Nous avons raison de l’être, parce qu’il y a, si je peux dire, une « solidarité morbide » qui nous lie à ces infortunés. C’est en effet dans les quartiers pauvres de la ville que les épidémies éclosent et se développent le plus rapidement. C’est de là qu’elles prennent leur vol irrésistible vers Turgeau, Bois-Verna, Bellevue, Pacot, Bolosse et autres lieux de plaisance. Les moustiques, gonflés d’hématozoaires, voyagent sur l’aile de la brise marine, de la mare fangeuse où ils pullulent aux résidences somptueuses qui ornent de leur guirlande fleurie les verdoyantes collines de Port-au-Prince. Et les microbes pernicieux de la tuberculose, de l’alastrim et de tant d’autres maladies effroyables — qui trouvent dans la malpropreté des quartiers populaires une condition propice à leur multiplication infinie — connaissent mille moyens ingénieux pour forcer l’entrée des villas les mieux closes.
L’intérêt le plus égoïste des riches — Haïtiens comme étrangers — exige donc en dehors même de tout sentiment d’altruisme, ou de simple bonté, qu’ils ne restent pas indifférents à l’inquiétante question d’hygiène privée et de salubrité publique qui se pose devant eux. Les Haïtiens, en particulier, ne peuvent pas supporter sans honte qu’un si grand nombre de leurs concitoyens vivent dans une pareille crasse et que leur capitale continue à offrir au visiteur étranger l’affligeant spectacle de ses quartiers misérables. On peut juger presque à coup sûr du degré d’éducation d’un individu par le souci qu’il montre, dans sa personne et dans son habitation, de la propreté et de l’hygiène. De même, on est porté à juger de la civilisation d’un pays par l’aspect de ses villes, leur propreté et le confort qu’on y trouve. Vous ferez difficilement admettre à un touriste étranger que le peuple haïtien est civilisé, quand il en voit une bonne partie croupir dans d’ignobles taudis, ou circuler à peu près nus ou couverts d’innommables guenilles dans les rues de la capitale.
Quelle joie de se promener dans ces nouveaux quartiers du BoisSchultz, si gais avec leurs pimpantes petites maisons, toutes fleuries ! Serait-il donc impossible d’avoir le même spectacle partout dans Portau-Prince ?… Des cités-jardins, des habitations salubres à bon marché pour les ouvriers, les artisans, les petits employés de commerce, les modestes fonctionnaires de l’État, c’est là, pensez-vous, rêve grandiose et inaccessible ? Etudiez de près le problème : vous verrez qu’il n’est pas plus insoluble en Haïti qu’il ne l’a été en France, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Hollande, aux États-Unis, dans la plupart des pays de l’Amérique latine. Si les hommes d’affaires veulent sérieusement s’y intéresser, ils se rendront compte que cette œuvre d’assistance sociale peut être aussi une entreprise lucrative.
De la collaboration de l’État, de la Commune et de l’initiative privée, résultera sans aucun doute une action bienfaisante qui, graduellement, transformera Port-au-Prince et les autres villes de ta République, tout en élevant le niveau moral des classes populaires et en développant leur rendement économique.
Voulant donner à ces idées une forme concrète et pratique, je demandai à mon ami, l’ingénieur Daniel Brun, d’étudier avec moi un plan de cité ouvrière, où serait établie cette collaboration nécessaire de l’État, de la Commune et de l’initiative privée. Je vais exposer dans ses grandes lignes ce projet, que M. Brun mit tout son cœur à préparer, sans autre préoccupation que de m’aider à fournir aux pouvoirs publics une base de discussion pour une réforme que nous estimions tous les deux de capitale importance. C’est l’unique pensée d’être utiles à la communauté qui nous détermina à soumettre plan, dessins, devis et calculs au Conseil Communal de Port-au-Prince en 1924. Je ne sais ce que sont devenus ces documents…
De: Dantès Bellegarde, Haïti et ses problèmes. Montréal : Éditions Bernard Valiquette, 1941.
Edition électronique de l’Université du Québec à Chicoutimi
En gras, surligné par G.M.