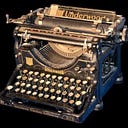Opérécheunne !
A l’occasion du 18 novembre, jour des Forces Armées
Publié le 2005–11–17 | Le Nouvelliste
Pour montrer le degré de servilité de la seconde armée haïtienne (1915–1995) aux Etats-Unis et au Marine Corps en particulier, nous allons raconter un petit fait que nous avons vécu à l’ancienne base aérienne du Bowen-Field début septembre 1994 et dont le héros était notre ami le Colonel Serge Bourdeau alors commandant de cette organisation militaire. Nous racontons cette histoire après avoir formellement obtenu la permission du Colonel Bourdeau. Nous luis avions promis de le faire dès que la parole serait libérée et nous tenons notre promesse. C’est un fait très instructif et de prime abord banal, mais en réalité d’une grande importance historique. Ce n’était un secret pour personne que le Marine Corps avait colonisé les cerveaux de nos militaires dont certains, même en 1994, considéraient les Américains comme des dieux. On peut signaler une foule de petits détails, comme le port du chapeau boy-scout des marines autorisé par le règlement haïtien de l’uniforme jusqu’en mars 1992 pendant l’embargo ; ou comme ces photos des commandants blancs de la Garde d’Haïti qui trônaient dans le bureau du commandant en Chef des FAD’H sur le même rang que les généraux haïtiens qui leur ont succédé. C’était une chose qui heurtait profondément les nationalistes haïtiens qui pénétraient dans ce bureau, mais il semble qu’une main invisible maintenait ces photos accrochées à leur place. Parmi toutes les organisations des FAD’H, la plus inconditionnellement américanophile était sans conteste le Corps d’Aviation dont le premier commandant, le colonel Edouard Roy (1942–1957) exigeait de se faire appeler «Sir» plutôt que «Mon Colonel» (authentique !) par ses subordonnés ou bien le colonel Jules André Commandant de la Garde d’Haïti, même après sa retraite, qui interpelait son vieil ami Paul E. Auxila, avec un «Hello Paurrrl!», empreint d’un accent américain affecté. Ainsi, peu de temps avant l’invasion de 1994, nous nous sommes rendu à l’aéroport militaire pour voir de nos propres yeux les préparatifs qui étaient faits pour repousser l’invasion. Nous désirâmes rendre également par la même occasion, une petite visite à notre ami le colonel Serge Bourdeau, le commandant du Corps d’Aviation (COMCORDAV). Nous vîmes d’abord des centaines de citoyens haïtiens en train de courir sur la piste en grand nombre ou en train de faire des pompes (push-ups) sur le tarmac de l’aéroport militaire. Le Colonel envoya un militaire nous chercher à la Salle de Garde qui nous escorta au bureau du commandant du Corps. Chemin faisant, nous remarquâmes avec le plus grand déplaisir sur notre trajet vers le bureau qui se trouvait dans un coquet pavillon sur une petite éminence, un grand nombre d’écriteaux en langue anglaise comme «Warehouse», «Toilet» (sans «e») «Office of the Commander», etc…, ce qui était en soi une situation intolérable. Au cours de notre entretien, il n’y avait dans le carré du Colonel Bourdeau que des officiers supérieurs, c’est-à-dire des lieutenants-colonels et des majors. Nous étions tous inquiets, car l’attaque des Américains qui voulaient «rétablir la démocratie» et leur protégé d’alors le Père Jean-Bertrand Aristide, était à ce moment-là inéluctable… On conjecturait sur les inévitables destructions matérielles et sur le nombre probable très élevé des victimes civiles et militaires que l’invasion américaine ne manquerait pas d’occasionner. La base aérienne sur laquelle nous nous trouvions serait peut-être, elle aussi, réduite à un tas de décombres. On discuta de la situation politique en général, de l’histoire des forces armées, du renvoi illégal de l’armée nationale par l’intervention américaine de 1915, de choses de l’aviation, de la malveillance du gouvernement des Etats-Unis vis-à-vis d’Haïti sur le temps, et de nombreuses autres questions dont nous ne nous souvenons pas. Par le plus grand des hasards, dans notre serviette, nous avions trois chapitres de notre volumineux ouvrage, que nous sommes toujours en train d’écrire sur la première armée haïtienne intitulé «L’Armée haïtienne en 1915», qui venaient de revenir de la dactylographie. Quels étaient ces trois chapitres ? a) La défense de l’Arsenal de Port-au-Prince par le Capitaine-Adjudant-major Chéry Germain les 28 et 29 juillet 1915. b) Les étapes du renvoi de l’armée nationale par l’occupant américain en 1915–1916. c) L’attitude de la classe politique et de la société civile face au renvoi de l’armée en 1915–1916. Tous les officiers se montrèrent extrêmement intéressés par ces chapitres que nous avions extraits de notre serviette pour les faire circuler parmi les assistants, qui ne savaient pas combien, avant trop longtemps ils seraient concernés eux-mêmes directement par ces chapitres «Ki moun k’ap wè Ti Sentaniz na gwo liv yo ?», aurait dit Maurice Sixto. Ils étaient bien incapables de se reconnaître dans ces pages. Mal d’autrui n’est que songe. « Pleurez plutôt sur vous-mêmes, femmes de Jérusalem !», aurait dit Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous leur lûmes quelques passages de ces textes et ces officiers furent particulièrement intéressés par les deux derniers chapitres de la petite liste, documents dont nous avons déjà publié des extraits dans Le Nouvelliste pour le plus grand plaisir de nos lecteurs. Puis, après environ une heure de visite, le moment de se séparer arriva ! Nous prîmes congé à regret de nos hôtes, et le colonel Bourdeau décida de nous raccompagner à notre voiture stationnée au parking. Nous appréciâmes énormément cette délicate marque de courtoisie du COMCORDAV. Cependant, en descendant le monumental escalier qui conduisait du pavillon du commandant au parking des véhicules, nous reprochâmes amicalement mais fermement à notre ami que le grand nombre d’écriteaux en langue anglaise sur les locaux de la base du Bowen-Field était inacceptable. Nous convînmes que l’anglais était la langue technique de l’aviation et que nous n’avions pas de problème que cette langue fût utilisée dans la documentation technique du corps, mais que ceci ne justifiait pas les inscriptions en anglais sur les murs d’une base aérienne qui appartenait à l’Etat haïtien qui est un Etat officiellement francophone et créolophone. Nous avions réalisé que nous avions fait mouche et que le Colonel avait accusé le coup et avait été totalement décontenancé… Ayant perçu que nous avions frappé un peu trop fort et que la dose avait été légèrement excessive, nous désirions passer un peu de baume, ne pouvant sans souffrir offenser personne, encore moins offenser un ami, nous mîmes un bémol à nos déclarations en lui disant qu’il avait dans sa base quand même quelques inscriptions en français comme «Salle de Garde» et dans un petit immeuble à étage qui était derrière nous et qui avait une grande pancarte au balcon où l’on lisait «OPERATIONS». Nous le lui signalâmes également, et alors avec tout son sang froid, le Colonel d’aviation nous dit que ne n’était pas «Opérations» mais «Opérécheunne» que nous lisions là-bas, et que cette inscription était aussi en anglais. C’en était trop ! Notre sang ne fit qu’un tour. Nous lui répondîmes que quand nous avions appris à lire, le Frère Clair nous avait appris à St-Louis que «r-a» faisait «ra» et que «t-i-o-n» faisait «sion». — «Opérations !», hurlâmes nous — «Opérécheunne !», hurla plus fort l’officier — «Opérations !», reprîmes nous, en haussant le ton — «Opérécheunne !», reprit-il, en haussant aussi le ton. «Opérations, Opérécheunne, Opérations, Opérécheunne !…» et ainsi de suite jusqu’à notre véhicule, le colonel devenant de plus en plus furieux d’être ainsi contredit… Nous prîmes congé de lui et nous partîmes pour ne plus jamais retourner au Bowen-Field, impressionné tout de même par l’américanophilie à tout crin d’un officier haïtien, alors que ces mêmes Américains s’apprêtaient à le réduire en cendres lui et ses hommes avec leurs armes terrifiantes, à l’humilier copieusement, dans le meilleur cas de figure. Puis arriva le 19 septembre 1994, le lundi noir. Les Américains débarquèrent, prenant le contrôle de la base. Le commandant américain s’installa confortablement dans le spacieux bureau du commandant haïtien, ne laissant au colonel Bourdeau qu’un petit réduit pour lui et ses officiers. Les hangars de la base furent couverts d’une multitude de nids de mitrailleuses et vus de loin, on ne pouvait s’empêcher de comparer les soldats américains sur ces installations à une nuée de sauterelles ou de criquets pèlerins dévorant une récolte. Nous n’avons pas pu devant ce spectacle affligeant ne pas nous remémorer «Les Sauterelles», un texte d’Alphonse Daudet dans «Lettres de mon Moulin» que nous aurions étudié au cours secondaire à Saint-Louis de Gonzague, et qui décrivait les ravages d’un essaim de sauterelles sur une plantation en Algérie. Le colonel Bourdeau fut remercié peu après, son corps dissous et les FAD’H démobilisées… L’immeuble principal, la tour de contrôle et les grands hangars qui pouvaient encore servir furent ensuite sauvagement rasés quelques années plus tard par le régime lavalas dans sa rage de faire disparaître à tout prix tout ce qui avait ou pouvait avoir eu une connotation militaire, de la même manière que le régime Dartiguenave à partir de 1916, s’acharna à faire disparaître tout ce qui pouvait nous rappeler notre passé militaire et qu’il fit démolir presque tous les forts qui entouraient Port-au-Prince, en particulier le Fort Saint-Clair à partir duquel les salves d’artillerie étaient tirées du rivage pour saluer les navires de guerre étrangers qui nous visitaient. De notre côté, nous dûmes nous exiler en mars 1995 pour échapper à un assassinat ce qui était un phénomène coutumier à l’époque dans la démocratie aristido-clintonienne, et quand les choses se calmèrent, nous revînmes en Haïti au début de la présidence de notre ami René Préval. A notre retour, nous décidâmes de ne pas utiliser de voiture, mais de circuler en taxi pendant quelques jours. Pendant notre absence aussi, le sens du trafic à la rue Pavée avait changé, de descendante, cette artère était devenue montante et nous attendions une voiture de ligne debout sur le trottoir de la Librairie Schutt-Aîné près du Parquet, aujourd’hui disparue, quand le premier véhicule que nous aperçûmes fut un pick-up conduit par le même colonel Serge Bourdeau en personne qui venait de chercher ses enfants au Collège Bird. Contant de nous voir, nous souriant, il ralentit et s’arrêta à notre niveau pour nous saluer. Nous lui rendîmes son large sourire, mais au lieu de dire «Bonjour!», nous lui dîmes simplement «Opérécheunne !» Il rit de bon coeur et nous dit que nous avions eu totalement raison dans notre interprétation des faits… Nous ne rapporterons cependant pas ses paroles en cette circonstance. Le Colonel jura mais un peu tard qu’on ne l’y reprendrait plus. Désormais quand nous nous rencontrons, c’est toujours la fête, mais lorsque nous nous saluons, nous le faisons en utilisant la formule «Opérécheunne» à l’exclusion de toute autre. Nous avons expliqué à notre ami le Colonel qu’il avait rendu ainsi service sans le savoir à son pays, que nous avions écrit une page importante d’Histoire, et qu’il rentrerait dans l’immortalité parce que ce petit fait anodin cocasse même, valait en réalité à lui seul une longue conférence pour illustrer le degré d’américanophilie de l’armée haïtienne, deuxième formule, et que de la même manière que le général Charles de Gaulle était passé à l’histoire sous le nom de «Colonel Motor» en raison de sa doctrine sur l’emploi des corps blindés-motorisés, lui, Serge Bourdeau, passerait à l’histoire sous le nom de «Colonel Opérécheunne». Nous avons rencontré en compagnie de notre fille Geneviève, tout récemment le Colonel Bourdeau dans un super-marché, faisant ses courses comme nous. Ce fut la même explosion de joie sans mélange qu’à l’accoutumée, ponctuée de part et d’autre par les exclamations «Opérécheunne!», désormais rituelles. Le Colonel nous demanda à cette occasion à quand la publication de notre article. Il a maintenant enfin satisfaction.
Georges Michel
Notes de G.M. Col. Bourdeau serait né 29 Aug. 1945