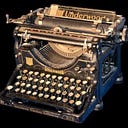Un problème structurel qui affectait les FAD’H
Publié le 2005–11–15 | Le Nouvelliste
Quand les Américains avec la complicité de leurs laquais indigènes ont balayé l’Armée et la Police haïtiennes en 1916, ils ont laissé une institution unique pour faire le travail de l’ancienne force publique haïtienne dans ses multiples composantes: armée de terre, marine, gendarmerie et police. Il est très surprenant de noter le grand nombre de textes, certains très anciens, qui régissaient cette force publique haïtienne dissoute: lois organiques, statuts, manuels d’instruction militaire, études, dont les plus célèbres étaient les règlements militaires du 31 juillet 1907, mis en vigueur sous Nord Alexis. Les Occupants américains dès 1917, publiaient un document unique, un maigre petit fascicule devant régir le fonctionnaire de leur création, la Gendarmerie d’Haïti, appelée “ Règlements Généraux de la Gendarmerie d’Haïti “. C’était un véritable chef d’oeuvre du genre. Ces Règlements Généraux traitaient de tous les aspects de la vie de la nouvelle Organisation. Ce document unique se préoccupait de choses allant jusqu’aux hernies et aux hydrocèles (maklouklou) des futures recrues. Certains passages feraient même pense à un manuel pour maquignons, ou à un manuel de marchands d’esclaves d’avant la Guerre de Sécession. (L’esclavage avait tout juste 45 ans depuis qu’il avait été aboli aux Etats-Unis). Les mêmes Règlements Généraux prétendaient imposer l’usage des degrés Fahrenheit pour la mesure de la température en Haïti, pourtant un pays officiellement de système métrique. En allant au fond des choses, nous avons pu en découvrir la cause, sans avoir à blâmer excessivement ce coup-ci les Américains. Comme on peut le supposer, les Américains imposèrent au peuple dominé les Haïtiens, ce qu’ils connaissaient chez eux, sans se préoccuper des traditions où de la culture juridique du peuple en question. C’est notre formation de juriste acquise à l’Université Quisqueya (1992–2002) qui nous a permis de tirer les conclusions suivantes. Les Haïtiens sont un peuple de la famille des droits romano-germaniques, c’est-à-dire d’une culture juridique de droit écrit. Tout doit être écrit noir sur blanc. Ce n’est pas le cas des Etats-Unis qui sont un pays de droit coutumier, hérité de leur ancienne métropole la Grande-Bretagne. Dans ces pays de droit coutumier il s’établit une coutume que tout le monde respecte, comme étant la loi. La coutume est une source majeure du droit à l’inverse de ce qui se passe chez nous, où la coutume est une source subsidiaire du droit qui ne sert qu’à combler les lacunes de l’écrit et la coutume est beaucoup plus fragile qu’en pays anglo-saxon. Récemment, en écoutant une émission radiophonique de Radio France Internationale (RFI), nous pouvions entendre un professeur de l’Université Paris II Panthéon-Assas confirmer notre déduction pour nous. L’éminent universitaire disait clairement que les sociétés francophones fonctionnent avec des modèles, et des modèles le plus souvent écrits, alors que les sociétés anglo-saxonnes ont une approche purement pratique des choses. La tradition des Règlements Généraux de la Gendarmerie d’Haïti de 1917 a perduré pendant près de 80 ans, si bien que dans un décret du CNG de juillet 1987, corrigé en septembre 1987, intitulé “ Règlements Généraux des Forces Armées d’Haïti “, document assez succint comme son ancêtre, on rencontrait un véritable pot-pourri (melting-pot devrait-on dire), où les différentes organisations militaires étaient définies, leurs missions, l’échelles des grades, certaines prescriptions relatives au personnel et aux séparations de service etc… Ce document publié d’ailleurs au Moniteur était un véritable chef d’oeuvre d’inadéquation et d’imprécision, mais on pouvait encore voir dans ses lignes la philosophie du Règlements de la Gendarmerie d’Haïti à nous imposé par le US Marine Corps en 1917. Ceci entraînait une conséquence directe. Les décisions des chefs militaires combleraient les vides du squelettique document écrit. Là où chez les Américains c’étaient des décisions discrétionnaires qui s’inscrivaient constamment dans une coutume respectée ou qui étaient le point de départ d’une autre coutume qui n’allait pas manquer elle aussi d’être autant respectée, en Haïti, ce n’étaient que des décisions arbitraires qui pouvaient ne générer que de la confusion ou parfois du ressentiment et de l’amertume chez des subordonnés. Souvent le silence des textes entraînait le refus d’agir ou bien la mise en oeuvre de décisions contradictoires par différents chefs militaires, cette situation était rendue pire quand il y avait l’intervention du pouvoir politique, ce qui est presque inconnu aux Etats-Unis. Cette situation facilitait aussi la tâche à des chefs militaires qui voulaient mal faire. Ce qui est absolument impensable aux Etats-Unis est parfaitement possible en Haïti avec des conséquences désastreuses, parce que la manière de pensée et les codes mentaux des deux sociétés et des deux peuples ne sont pas les mêmes. L’un des défauts les plus graves de cet édifice institutionnel laissé en place par le Marine Corps et la première Occupation (1915–1934) est l’absence d’un texte régissant explicitement le statut du personnel comme cela existait en Haïti avant 1916, comme cela existe en France, ou comme cela existe chez nous pour les agents de la fonction publique. (Loi du 19 septembre 1982). L’absence d’un tel statut a causé chez nous de 1934 à 1995 bien des déboires, avec la mise à la merci du personnel militaire des caprices de la hiérarchie ou de ceux du pouvoir politique. On a vu avec quelle facilité déconcertante des quantités de militaires ont été arbitrairement chassés des cadres de l’armée entre 1934 et 1995, surtout entre 1957 et 1986, où les purges pratiquées par les Duvaliers dans l’Armée, surtout par le père Duvalier, sont demeurées tristement célèbres. On parle maintenant beaucoup de troisième armée haïtienne. C’est absolument inutile d’en parler si on ne prévoit pas une loi pour le personnel militaire pour nous éviter de nouvelles mésaventures. La nouvelle armée rénovée doit aussi avoir pour son personnel un statut analogue ou homologue du statut qui existe en Haïti pour les fonctionnaires publics. Pas de statut du personnel, pas la peine d’aller plus loin en matière d’armée. D’autres documents légaux pertinents devraient être votés par le Parlement pour gérer également les autres domaines de l’institution militaire. La gestion de la troisième armée doit être ôtée aux militaires. Ces derniers doivent dépendre d’un Ministère de la Défense dont le titulaire doit être en principe un civil. C’est ce Ministère qui doit être chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement de la République en matière de défense nationale, dans le strict respect de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur. L’affaire ne s’arrête pas là. Les Occupants américains mirent sur pied un système judiciaire parallèle pour leur nouvelle force en 1915, un système qui n’avait rien à voir avec le système de droit commun dont étaient justiciables l’ensemble des citoyens haïtiens, c’est-à-dire tous ceux qui n’étaient pas membres de la Garde d’Haïti. Les Américains, on le sait, sont capables quand ils occupent un pays, des pires monstruosités juridiques. Leur Gendarmerie n’avait jamais été acceptée par l’ensemble du corps social haïtien. A cause des railleries, des quolibets, de l’ostracisme dont ils avaient fait l’objet, de la part de leurs parents et amis notamment, les cadets de la première promotion de 1916 avaient tous démissionné en 1917 et la première tentative d’organiser une école militaire pour la Gendarmerie afin de lui fournir tout de suite des officiers indigènes avait tourné court. Les choses allaient être plus difficiles que prévu pour les Américains qui fermèrent cette première école militaire dès 1917. Ils trouveraient désormais leurs officiers haïtiens à partir des enrôlés haïtiens les plus méritants, l’un de ceux-là fut le colonel Démosthènes P. Calixte, premier commandant haïtien de la Garde au moment de la première Désoccupation en 1934. En 1924, lors des élections législatives avortées de par la volonté du régime Borno et des autorités de la première Occupation, les nationalistes haïtiens avaient réclamé en vain le renvoi de la Garde d’Haïti comme institution antinationale et corps de suppletifs américains, et la reconstruction immédiate dans ses deux composantes policière et militaire, de l’ancienne force publique haïtienne renvoyée illégalement et arbitrairement par l’Occupant américain et par ses séïdes du gouvernement client en1916. En 1930, à six ans de la fin prévue pour la première Occupation, il n’y avait toujours dans la Garde que deux (2) capitaines haïtiens. Tout le reste du personnel officier était américain, la plupart étaient des sous-officiers du Marine Corps qu’un tour de passe-passe avait promu “officiers haïtiens”. A partir de 1930, les jours de la première Occupation était désormais comptés, on dut haïtianiser les cadres de la Garde en quatrième vitesse, devant la désoccupation inéluctable qui approchait à grands pas. Pour créer et maintenir cette situation inhabituelle et intolérable pour les Haïtiens, les Américains avaient créé un système judiciaire indépendant pour leurs supplétifs et ils avaient également rendu tous les Haïtiens qui se seraient rendus coupables d’infraction contre les membres de la Garde, Haïtiens et Américains, comme aussi contre les militaires américains des troupes d’Occupation, justiciables de la “Cour Prévotable”, c’est-à-dire du tribunal militaire américain (un peu comme les “tribunaux” prévus pour les prisonniers de Guantanamo) qui jugeait selon son bon plaisir. Les procès devant cette juridiction anormale étaient souvent expéditifs, de véritables parodies de justice qui ressemblaient à de véritables procès staliniens avant l’heure. La première Désoccupation eut lieu en 1934, mais les séquelles de cette situation durèrent pendant très longtemps, jusqu’à la Constitution de 1987 et même jusqu’à la démobilisation des FADH en 1994. A partir de 1934 jusqu’en 1987, les militaires haïtiens étaient eux-mêmes soumis à une justice expéditive héritée du Marine Corps pour les infractions militaires ou non militaires. Leurs droits même de citoyens haïtiens et de simples justiciables étaient violés. Ce n’est qu’après la Désoccupation que la Cour de cassation haïtienne put connaître des décisions des tribunaux militaires maintenant haïtiens, qui continuaient à juger cependant selon les principes et méthodes que leurs avaient léguées les Occupants américains qui avaient régné en maîtres absolus dans ce pays entre 1915 et 1934. Les tribunaux militaires de l’Occupant s’étaient trouvés ainsi pendant une longue période au-dessus de la Cour suprême haïtienne. Le caractère expéditif de cette justice militaire américaine qui nous avait été laissée en héritage par la première Occupation, a permis à François Duvalier notamment d’envoyer avec une caricature de légalité, de nombreux innocents, civils et militaires, au poteau d’exécution, selon son bon plaisir. Ici encore, contrairement à ce qui se serait passé dans une socité de culture anglo-saxonne, l’influence modératrice et salutaire de la coutume, n’était pas là pour tempérer de pareils excès. C’est la volonté de tourner définitivement le dos à de pareilles horreurs qui a conduit les constituants de 1987 à voter à l’unanimité l’abolition de la peine de mort en Haïti, comme les constituants allemands de 1949 avaient aboli la peine de mort en Allemagne après la chute du régime nazi. La Constitution de 1987 réservait par ailleurs la justice militaire aux seules infractions contre le règlement militaire, comme cela existait en la matière avant la première Occupation. Ceci représentait pour les militaires haïtiens une grande avancée dans la restauration de leurs droits. C’était un pan important de l’édifice de la première Occupation qui s’écroulait ainsi. C’était le retour à la situation qui existait en Haïti avant cette première Occupation où des militaires pouvaient être attraits devant une juridiction de droit commun pour une infraction de droit commun. C’est l’approche de pays comme la Grande-Bretagne où la France avant 1981. Cette dernière a même été plus loin, en supprimant carrément les tribunaux militaires en temps de paix. A preuve de ce que nous affirmons, nous extrayons du Nouvelliste du mercredi 29 juin 1910 l’entrefilte suivant: “LA PROVINCE Petit-Goâve.- Le Général Maximus Maxéan (sic), chef du quartier de Gressier, prévenu de violences sur la personne de Moléus St-Félix et de Tirésias St-Félix, a comparu en audience correctionnelle le jeudi 9 Juin. Partie civile: Me E. Fanfant. Le Général a été condamné à une année d’emprisonnement et à des dommages-intérêts.” Ceci ne s’était plus vu en Haïti depuis 1915, qu’un militaire en activité de service soit condamné par un tribunal civil pour une infraction ne relevant pas directement des questions militaires. Des entrefilets du même genre sont très nombreux dans les journaux d’époque, de même que ceux qui relatent les décisions des tribunaux militaires. Nous signalons aussi pour mémoire que ce même officier quelques années plus tard en 1915 sera commandant de la commune de Léogâne et adjoint du commandant d’Arrondissement Charlemagne Péralte, et que le jour de la chute de Vilbrun Guillaume Sam, il sera lynché par la population léogânaise en raison des multiples exactions qu’il avait commises contre cette population. Roger Gaillard parle en détail de cet épisode dans son ouvrage “Premier écrasement du cacoïsme”. Les droits des militaires haïtiens étaient encore violés quand les règlements militaires leur imposaient d’obtenir une autorisation du Grand Quartier Général pour pouvoir rester en justice, ou comme demandeur ou comme défendeur. Les droits des autres citoyens étaient également violés quand il fallait pour eux dépendre de cette autorisation du G.Q.G. pour pouvoir attraire un militaire devant un tribunal, même en matière civile. La justice militaire, depuis le renvoi de la première armée nationale en 1916, était administrée selon les prescriptions du Manuel de Justice Militaire (MJM) qui était la traduction française maladroite d’un document correspondant du Marine Corps qui était à la fois Code pénal militaire et code de procédure pénale militaire, procédure carrément anglo-saxonne. Ce Manuel était sans rapport aucun avec notre culture juridique et était comme une véritable verrue dans notre société. Ce MJM mis en vigueur d’autorité en Haïti par le Marine Corps remplaçait le Code de Justice militaire pour les troupes de terre et de mer en usage depuis la présidence de Geffrard en 1860 et dont la dernière édition datait de 1912. Ce texte haïtien était, comme on peut le supposer, largement inspiré du texte français correspondant, lequel est encore en vigueur dans les forces armées françaises juqu’à nos jours. Ce Code de Geffrard était à la fois Code pénal militaire et Code de procédure militaire, mais il suivait la philosophie juridique d’un pays de droit écrit, à l’inverse du MJM. Le Général Cauvin avait fait une volumineuse étude exhautive de ce Code sous la présidence de Salomon en 1881. Quand nous enseignions l’Histoire militaire et la Polémologie à l’Académie militaire d’Haïti en 1989–1991, nous avions signalé l’existence de cet ancien Code de justice militaire haïtien aux élèves-officiers de la Promotion “Cacique Henri”. Nous n’étions pas juriste à l’époque et nous ne pouvions porter de ce fait aucune opinion qualifiée sur ces deux codes militaires, l’ancien et le nouveau. Il nous serait encore difficile de le faire aujourd’hui n’étant pas nous-même militaire, et devant de ce fait nous reposer sur les hommes de l’art pour avoir une opinion qualifiée. Avec la promotion suivante, la Promotion “Capitaine Chéry Germain”, la Direction de l’Académie, à notre requête, nous donna un assistant professeur en la personne du très brillant sous-lieutenant Youri Latortue (arrière-petit neveu du célèbre Polytechnicien le général artilleur Xavier Latortue dit Coubas, commissaire militaire d’Haïti à l’Exposition Internationale de Jamestown en 1907 aux Etats-Unis) et major de la Promotion précédente “Cacique Henri”. C’était the right man in the right place. L’arrivée du Sous-Lieutenant Latortue à la chaire d’Histoire militaire et de Polémologie nous permit d’expandre notre cours et d’en élever le niveau, alors qu’un homme de l’art (Latortue) enseignerait sous notre direction, les parties spécifiquement militaires de ce cours. C’est ainsi que nous confiâmes au sous-lieutenant Latortue notre assistant, l’enseignement des différents règlements et manuels d’instruction militaire qui étaient en usage dans nos forces armées jusqu’à leur renvoi en 1916. Ce corpus de documents comprenait notamment le règlement militaire du 31 juillet 1907, les différents manuels d’instruction militaire qui étaient en service dans notre armée avant 1916: titre I base de l’instruction, titre II école du soldat, titre III école de compagnie, titre IV école de l’officier, titre V école de bataillon, le Règlement du Service de Santé de 1910 et enfin et surtout le Code de justice militaire de Geffrard, éditions de 1860 à 1912. Le lieutenant Latortue s’acquitta consciencieusement et avec compétence de cette tâche. Par curiosité, nous lui demandâmes par la suite son opinion comparative sur les deux Codes de justice militaire et il nous répondit en connaissance de cause que le Code de Geffrard était immensément supérieur au MJM. Nous eûmes également un peu plus tard l’occasion d’avoir un autre avis allant dans le même sens par la bouche d’un autre officier le Lieutenant-Colonel Jean-Claude Occénad. Au début de l’année 1995, une Commission avait été formée par le régime lavalas pour refondre les règlements des FADH. Il n’était pas encore question du renvoi pur et simple de l’Armée. Une autre sous-commission devait également se pencher sur la refonte de la justice militaire à la lumière des progrès juridiques qui avaient été réalisés dans notre pays, à partir de 1986 notamment. Notre ami le Lieutenant-Colonel Jean-Claude Occénad du corps des Transmissions était membre de cette sous-commission. Il étudiait en même temps que nous le Droit à l’Université Quisqueya. Ayant appris que nous avions en notre possession le texte du Code de Geffrard, il nous en demanda une photocopie. Chose dite, chose faite. Après avoir remis la photocopie du document à cet officier supérieur, nous lui demandâmes de ne pas manquer de nous faire avoir honnêtement son opinion sur ce texte après l’avoir lu. Quelques jours après, le colonel Occénad rejoignait exactement l’opinion déjà émise séparément et quelques années plus tôt par le lieutenant Latortue, à savoir que le Code de Geffrard était bien supérieur et bien mieux structuré que le MJM que nous avait légué la première Occupation, et il s’interrogea même sur le pourquoi de l’élimination de ce Code par les Américains et son remplacement par ce fameux M.J.M. Ce problème de la justice militaire devrait être intégralement abordé et réglé dans notre nouvelle armée en projet et on se demande s’il ne faudrait pas remettre carrément en vigueur le Code de Geffrard avec quelques retouches, la peine de mort en moins par exemple, car elle est officiellement abolie dans notre pays depuis 1987. D’une manière plus générale, les rapports de la nouvelle armée haïtienne avec l’écrit doivent être réglés en tenant compte de nos besoins et de nos traditions.
Dr Georges Michel